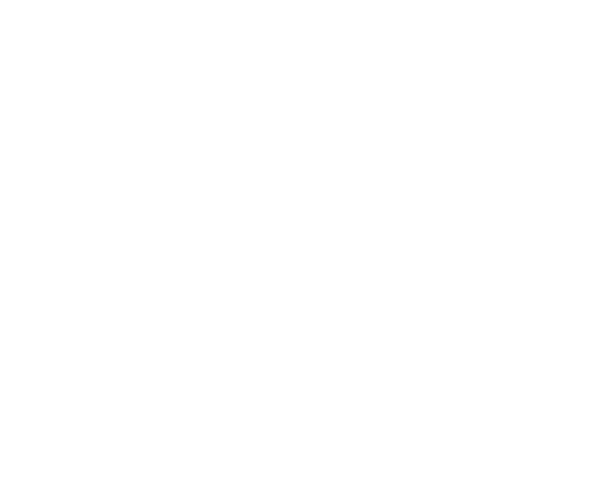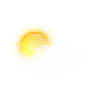Les pistes et le damage
Le domaine nordique d’Agy
Il s’étale sur une vaste croupe, entre Arve et Giffre, sur les communes de Saint-Sigismond, d’Arâches-la-Frasse et de Morillon.
Si l’on considère le domaine dans son entière potentialité (ski, piétons et raquettes, chiens de traîneau), cet espace nordique couvre une zone de moyenne montagne d’environ 300 ha, inscrite dans un vaste triangle dont les 3 sommets sont le relais de télévision (Agy – 1270 m), le parking des Grangettes (les Carroz – 1270 m) et les Praz (Morillon – 1238 m).
L’espace situé sur Morillon est essentiellement utilisé par le Muscher et les randonneurs en raquettes : il n’est pas exploité par l’association et ne fait pas l’objet d’une DSP.
Le domaine skiable, à proprement parler, s’étend du parking d’Agy jusqu’à l’Artoche et se répartit de manière équivalente sur Arâches et Saint-Sigismond. Il fait l’objet d’une Délégation de Service Public par le SIVU d’Agy, regroupant les deux communes.
La liaison Artoche – les Grangettes (6 km) est un itinéraire nordique balisé (ski, piéton, raquettes) entièrement réparti sur la seule commune d’Arâches-la-Frasse.
Le réseau de pistes en constante amélioration
Projets et suivis des travaux ont été réalisés, au début, sous la houlette de Jean Pellier-Cuit dont je fus l’élève assidu, avant de prendre à mon compte cette responsabilité. Plus tard, c’est avec Jean-Luc Mattel, notre chef d’exploitation, que je poursuis cette mission passionnante…
Depuis 50 ans, on a dû s’adapter aux nouvelles pratiques (skating, piétons, raquettes, chiens de traîneau), aux contraintes de damage et de sécurité, et aux conditions climatiques.
Au commencement, il n’y a que deux pistes, empruntant les chemins d’été de l’époque :
– la 5 km emprunte sensiblement le tracé actuel de la piste bleue « les Charmettes », mais on part tout droit jusqu’à la Borde (tracé actuel de la piste forestière – idem pour le retour)
– la 8 km suit le même trajet jusqu’en haut de la piste bleue, puis prend à droite pour rejoindre la combe par le chemin d’été, (tracé surnommé « violette ») en sens inverse du sens actuel de la piste rouge « l’Artoche ». Le retour emprunte l’ancien chemin d’été avec une descente vertigineuse jusqu’au bas des Charmettes, avant une montée raide pour rejoindre le chalet Verneret (bout de la bleue actuelle).
Le foyer s’équipe bientôt d’une dameuse rouge. Elle a déjà bien vécu, elle se plante souvent, quand elle n’arrache pas la neige dans les virages trop serrés pour elle. On s’aventure au bout de la bleue où le virage gelé du petit bois nous attend, sur le retour. Il faut éviter l’arbre qui a tendance à traverser la piste juste quand on passe le virage. Plus tard, on risque la rouge.
Elle est réservée aux meilleurs qui découvrent, en rentrant, la fameuse descente du chemin creux. Tous ceux qui l’ont descendue s’en souviennent. « Y a persooonne par terre, la piste est liiiibre ? » Pas de réponse… « Tu peux y aller » et comment que ça y va… Y en a pas beaucoup qui restent debout. Quelle fierté quand on n’y pose pas les fesses et qu’on l’encape sans tomber ! À se demander comment les mômes ont pu apprendre à skier dans ces conditions.
Jean Gnaedig – extrait du livret du 25ème anniversaire
Les premiers travaux réalisés sur les pistes débutent en 1977, avec la création de virages pour adoucir les côtes du départ. En 1979, on crée une petite boucle d’initiation de 800 m, sous le foyer. Cette piste, qu’on appellera plus tard « la jaune », correspond à la boucle du stade du Pornet actuel.
Au début des années 80, est créée la 15 km qui utilise les chemins d’exploitation de la ligne EDF.
La 15 km emprunte le même circuit que la 8 km, mais bifurque à droite, juste après le sommet de la bleue, pour suivre la ligne électrique jusqu’en haut de la Borde, avant de tourner à 180°, direction Fimaloz, puis de remonter pour rejoindre à nouveau la ligne électrique et enfin la 8 km.
En gros, on rajoute à la 8 km la piste piétonne (B) actuelle, depuis la Borde.
Au cours de la décennie, chaque année, des travaux conséquents sont réalisés pour améliorer le profil très difficile de nos pistes et offrir plus de diversité.
En 1983, le domaine skiable comprend 4pistes : 800 m, 5 km, 10 km et 15 km.
On crée de toutes pièces le départ actuel commun à toutes les pistes, la déviation de la descente des Charmettes, le plat de la rouge (retour), la verte du Pornet, la liaison Fimaloz→ Artoche…
Le stade du Pornet
Une première approche est réalisée avec la constitution de la plateforme sur laquelle on bâtira le chalet du ski-club en 1988, grâce aux pierres ramassées sur les pistes lors des corvées.
En 1991, nous avions bricolé un petit tremplin pour une démonstration de saut, avant le départ de notre nocturne. La formule avait plu. Je contacte alors Pierre Bailly, entraîneur de saut à ski au comité du Mont-Blanc, pour me conseiller sur l’implantation d’un tremplin permanent. L’emplacement choisi se trouve sur la butte, à l’ouest du parking. Le projet est dessiné et chiffré (30 610 F TTC). Il s’agit d’un tremplin de 20 m, idéal pour l’initiation. On utilise la pente naturelle qu’on modifie légèrement pour respecter les rayons de courbure, avec un remblai sur le haut (plateforme de départ) et sur le bas (aire d’arrivée). La longueur totale mesure 80 m et doit être recouverte de rouleaux de fibre polyester, autorisant la glisse en toutes saisons.
Le club est prêt à financer le projet. Malheureusement, la mairie s’y oppose.
En 1996, on procède au terrassement du stade du Pornet, profitant des gros engins déployés pour la réalisation de la piste forestière. Hélas, le projet initial sera amputé, suivant les recommandations de l’ONF. Aujourd’hui encore, la manque d’espace y est criant !
La décennie suivante, des modifications de tracé moins importantes interviennent également :
Il fallut d’abord élargir progressivement toutes les pistes (versant nord) pour permettre la pratique du skating apparu vers 1985.
Plus tard, on abandonne aux piétons les pistes du versant sud (la Borde → Fimaloz → l’Artoche) pour canaliser l’afflux croissant des promeneurs, et le bas du versant nord (Flatières → Charmettes → Tréchard) pour la pratique du chien de traîneau.
Quelques aménagements au niveau de la Borde sont entrepris pour éviter des secteurs en versant sud, qui déneigent trop vite. Il faut dire que l’hiver 1990 (seulement 3 semaines d’ouverture) et les suivants sont très déficitaires au niveau enneigement !
Les années 2000 ne connaissent que peu d’évolution, bien qu’il y ait encore de réels besoins.
On crée une pente de luge sécurisée en 2006, sous l’impulsion de Jean-Luc Mattel.
On apporte quelques modifications (bout de la bleue et rouge de Tréchard en 2006, piste noire) et on change le sens de circulation de la piste rouge.
Pour l’hiver 2021, on innove, en déplaçant le départ piéton. L’itinéraire piéton part tout de suite sur la droite en longeant la piste de ski, avant de bifurquer sur le versant sud, au niveau de la première bâche (abreuvoir pour le bétail de l’alpage). À l’automne suivant, on aménage la pente de la butte, au dessus de la Borde, pour faciliter le passage des piétons.
Les plans de pistes évoluent
On baptise les pistes au moment où l’offre ski de fond est à son maximum.
« Dans cet écrin blotti entre Arve et Giffre, toutes les pistes portent un nom de pierre…
Découvrez ce joyau du ski sauvage »
peut-on lire sur notre dépliant de l’époque.
Il y alors 3 pistes (Fluorine, Émeraude et Opaline) sur le plateau inférieur entre le stade du Pornet, les Flatières, les Charmettes d’en bas et la combe sous Tréchard. Ce domaine est ouvert aux pratiquants du pas de patineur (skating), alors que sur le plateau supérieur seul le pas alternatif (classique) est autorisé.
Sur le plateau supérieur, il y a 3 pistes également : la bleue (Turquoise), la rouge (Cornaline) et l’Améthyste (8 km) qui joint la Borde à l’Artoche, en passant par Fimaloz.
Enfin, l’Obsidienne (12 km) fait le tour du plateau, passant du versant sud de l’Améthyste au versant nord de l’Opaline.
Puis on revient à des noms plus conventionnels (celui des lieux-dits) lorsqu’on abandonne une partie du réseau au profit des autres pratiques. Tout le réseau est désormais ouvert aux deux pratiques.
Après l’abandon des pistes Améthyste et Opaline, on crée une nouvelle piste rouge (Tréchard) en 2006, qui constitue une boucle de 4 km à partir du chalet Verneret (bout de la bleue) jusqu’à la Combe sous Tréchard.
On décide ensuite de relier le bout de la rouge à ce tracé. C’est ainsi que la noire « Marvel » apparaît, puis prend le nom de Tréchard, quand mes successeurs abandonnent cette nouvelle rouge qui présentait un réel attrait
Les dameuses
La conduite est sportive et le pilote doit avoir une forme olympique pour franchir ces fameuses montées : dételer le dispositif de traçage, monter d’abord la motoneige, parfois en courant à côté, puis redescendre chercher l’attelage, le tracter derrière soi et raccrocher le tout. Bien que cela constitue un net progrès, les pistes demeurent étroites et peu stables.
Le matin, avant d’ouvrir le restaurant, je partais tracer les deux pistes en montant par l’ancien chemin vicinal. Pendant ce temps-là, Yves Détry fartait les skis et accueillait les premiers clients.
René Dufermont
En 1978, notre première chenillette d’occasion, l’Iseran, apporte plus de confort, autant pour les skieurs que pour le pauvre dameur, qui n’a plus à courir à côté de son engin. Toutefois, ce modèle est très rudimentaire : équipé d’un moteur de Coccinelle VW, avec une transmission par courroie. Il faut s’y reprendre de nombreuses fois pour tracer les virages !
L’Iseran est remplacé par une vieille Kässbohrer 125, en automne 1981.
Les traceurs ne sont pas relevables et il n’y a pas de fraise pour retravailler la neige : imaginez la descente des Charmettes, avec deux traces toutes gelées jusqu’en bas…
Il faut une bonne dose d’inconscience pour s’y lancer ; d’ailleurs beaucoup descendent en escalier, voire en sorcière pour les plus téméraires.
Cette dameuse est remplacée en 1986 par un modèle plus récent (PB 100), équipé d’une fraise et de traceurs relevables. Son point faible est son manque de puissance, qui limite les travaux de bullage.
En 1991, le foyer fait l’acquisition d’une seconde dameuse, une Leitner 360 (90 076 € HT). Plus puissante et plus large, elle apporte de la modernité dans la préparation des pistes.
La petite PB 100 reste indispensable pour le damage des chemins piétons et le damage par faible enneigement.
Au printemps 2000, la Leitner 360 (revendue au foyer de la Chapelle Rambaud à 22 900 €) est remplacée par une Kässbohrer PB 280, moins lourde et plus maniable.
En 2005, la commune de Saint-Sigismond loue une nouvelle PB 100 puis en fait l’acquisition en 2007, pour remplacer l’ancienne qui ne fonctionne plus.
En 2017, le SIVU d’Agy acquiert une PB 600 (modèle 2006, 2 fois remise à neuf), pour remplacer la PB 280 arrivée au bout et revendue à l’été 2017.
Désormais, le parc machine est uniquement propriété du SIVU d’Agy. Au cours de l’hiver 2021, on procède à des essais de machines de dernière génération (PB 100 et Prinoth Husky).
L’objectif est de n’avoir plus qu’une seule machine à entretenir. La nouvelle génération de ces engins offre suffisamment de puissance pour le bullage, sur les modèles typés nordique.
Les anciennes machines sont revendues et c’est finalement le modèle Prinoth qui est commandé pour la saison 2021/2022.
On procède dans le même temps à l’achat d’une nouvelle motoneige pour l’intervention sur les secours. Le montant de l’investissement total est de 240 000 €, financé par le SIVU d’Agy, avec une subvention de 100 000 € attribuée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Les autres véhicules
Outre les dameuses, le Centre Nordique dispose de véhicules légers pour les secours, le balisage et l’entretien des pistes. Presque depuis le début, on utilise une motoneige. Plusieurs modèles se sont succédé au fil des ans.
Ce matériel permet des interventions rapides sur tout le domaine. Cependant, il faut qu’il y ait de la neige sur l’ensemble du parcours, ce qui n’est pas toujours le cas, en début comme en fin de saison.
En 2004, la commune fait donc l’acquisition d’un quad chenillable qui vient en complément de la motoneige.

Agy et Grand-Massif
Dans les années 70, la mode est aux longues pistes sillonnant crêtes et forêts.
C’est animés du même esprit pionnier que nous avons cherché à explorer tout le potentiel nordique :
Sur le versant sud, le parcours de notre course populaire « la Couerna » nous fait explorer quelques secteurs avec nos amis des Carroz. On étudie un tracé retour entre l’Artoche et les Grangettes, en passant par les Mouilles, la Naz, les Granges, le Toral, le Parchet… Mais les hivers sans neige, au tournant des années 90, ont tôt fait de calmer nos ardeurs. On envisage bien plus tard de prolonger la route des Grangettes pour offrir une liaison avec moins de dénivelé.
Finalement, le système des navettes s’avère le moins onéreux et le plus approprié !
En 1991, je présente un projet de liaison Agy→ Morillon, lors du remplacement du télésiège de la Vieille, désormais composé de deux tronçons. À la gare intermédiaire, il suffit de traverser la piste d’alpin aux Praz de Marvel pour rejoindre notre « Opaline » et créer une belle boucle sur le secteur les Praz → les Laurents. J’avais déjà proposé une petite boucle sur le plateau de la Charniaz, aux Esserts, quelques années plus tôt.
De 2002 à 2011, le Centre Nordique obtient la gestion du site de Pierre Carrée, à Flaine.
Là aussi, avec Jean-Luc Mattel, nous avons cherché à exploiter toutes les potentialités du domaine. Un plan avec trois secteurs (Arbaron, Combe Enverse, Vernant) est projeté, avec pas de tir biathlon (sur l’ancienne déchetterie) qui serait géré par le 27° B.C.A.
Comme à Agy, Jean-Luc pousse de la neige avec la dameuse pour combler les trous et redresser les dévers : ainsi, on crée de nouvelles pistes qu’on teste l’hiver, avant de proposer des travaux au printemps.
Flaine Pierre Carrée un domaine hors du temps, hors des conceptions nordiques ordinaires. Plus de neige que toute la Haute-Savoie réunie, plus de bullage que de damage, plus de dénivelés que de plat, plus de virages que de lignes droites, plus de dévers que d’horizontalités. Une véritable école d’entretien de piste. Un décor féerique, des sapins croulants sous la neige, une vue à couper le souffle. Malheureusement trop peu d’utilisateurs, trop peu d’investissement pour faire de ce lieu un espace nordique d’altitude d’une autre dimension, qu’il aurait mérité d’être.
Jean-Luc Mattel